HISTOIRE
LE SITE
DES VOYAGEURS
QUI ONT DU
 |
Depuis le 19ème siècle la
France cherchait à établir une base commercial dans la Corne de
l’Afrique. |
|
Le 11 mars 1862 un
traité fut signé entre Thouvenel, Ministre des Affaires Etrangères
et Dini au nom des Sultans de Raheita, de Tadjourah et du Gobad.
Il portait cession du mouillage d'Obock et de la côte depuis le
ras (cap) Ali jusqu'au ras Doumeira.
Ainsi dès Le 20 mai le pavillon français fut hissé à Obock pour la première fois, mais, jusqu'en 1881, seul un vieil Afar était chargé de sa garde. Les convoitises de l'Egypte sur ce territoire, et la nécessité d'assurer, au débouché de la Mer Rouge, le soutage des navires français faisant route vers le Tonkin, décidèrent la France à désigner un gouverneur. |
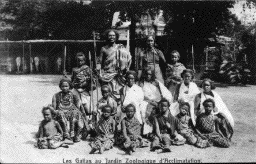 
|
 |
Le 29 décembre 1883, le vicomte Léonce Lagarde de Rouffreyroux était nommé "Commissaire du Gouvernement en mission spéciale à Obock pour la reconnaissance et la délimitation du territoire d'Obock". Il signa des traités de protectorat avec les Sultans Afars et avec l'Ougas (chef suprême) des Issas. Ce traité va en fait ouvrir la porte à l’hégémonie française sur tout le territoire. En effet dès 1888 les français ne se contentent plus d’obock et décident d’ouvrir un port plus au sud au cap Djibouti sur lequel il installe le siège du gouvernement en 1892.En 1893 Djibouti compte 1.200 habitants |
En 1895, les services administratifs s'installent à Djibouti : la nouvelle capitale. La ville se dote alors des équipements nécessaires : installations portuaires, maison de commerce et bâtiments administratifs. Enfin, la construction des Salines et du Chemin de fer donnent la physionomie générale de la ville, qu'elle conserve jusqu'à la Deuxième Guerre Mondiale.
De 1898 à 1917 la construction du chemin de fer Djibouti Addis-Abéba consacrera Djibouti comme porte maritime de l’Ethiopie. Entre-temps et peu à peu, la ville s'est bâtie des artisans yéménites et pakistanais construisirent ces splendides maisons qui constituent le cœur de la cité et que l'on peut toujours admirer lors d’une ballade au centre ville.
L’après guerre marque l’élan vers un désir d’autonomie et d’indépendance. Dès 1945, un Conseil Représentatif formé de deux sections, française et autochtone, envoya des délégués à l'Assemblée Nationale française.
Jusqu’en 1939 le pays connut un essor important grâce aux transport de marchandises (par bateau ou par train), l’exploitation des salines, et une main d’œuvre locale bon marché. Puis ce fut les années de guerre, à laquelle prit part le pays en tant que colonie française. Les anglais qui avaient instauré un blocus causèrent une grande famine. Par la suite les chantiers étant finis et la population augmentant, la pauvreté commença.
| En 1956, la promulgation de la Loi-cadre institua une Assemblée Territoriale, élue au suffrage universel, et un Conseil de Gouvernement de huit ministres. M. Mahamoud Harbi devint le premier Vice-Président du Conseil. En 1958, il se déclara favorable à l'indépendance immédiate du territoire et fit campagne en faveur du "NON" au référendum constitutionnel ; mais les élus locaux, sous la conduite de MM. Hassan Gouled et Mohamed Kamil, optèrent pour le "OUI" M. Mahamoud Harbi, désavoué, s'expatria en 1960 à Mogadiscio où il fonda le Front de Libération de la Côte des Somalis (FLCS), avant de périr dans un accident d'avion. La même année, M. Ali Aref devint Vice-Président du Conseil de Gouvernement. |  |
 |
La visite du Général de Gaulle, en 1966, donna lieu à de graves incidents. La foule venue l’accueillir en prônant son désir d’indépendance est violemment réprimée . Le 19 mars 1967, un premier référendum fit repousser l'indépendance par 60 % des voix. Ce résultat occasionna des émeutes, puis la dissolution du Parti du Mouvement Populaire de M. Hassan Gouled Aptidon qui avait fait campagne pour l'accession à l'indépendance. La Côte française des Somalis devient alors Territoire français des Afars et des Issas, M. Ali Aref présidant le Conseil du Gouvernement et un Haut-Commissaire représentant le Gouvernement français. |
| 10 ans plus
tard, le 8 Mai 1977, un référendum instaure l’indépendance :
la République de Djibouti est instaurée avec à sa tête le président
Hassan Gouled Aptidon.Le pouvoir reste concentré entre les mains
des Issas, et en 1991 une guerre civile éclate, menée par la rebellion
Afar qui demande une représentation politique équitable des deux
ethnies. Des accords de paix seront signés mais18 000 Afars seront
chassées par cette guerre et se réfugieront dans une région Afar
d’ Ethiopie. |
 |
En
1992 les premières élections multi-partis ont lieu. Elles seront
boudées par la communauté Afar car les accords signés en 1991 n’ont
pas été respectés.
En mai 1993, le Président Hassan Gouled Aptidon est reconduit à la tête
de l'Etat pour un quatrième mandat. Peu après, l'armée nationale investit
la zone tenue par la guérilla Afars (les trois quart du pays).
En décembre 1994, le gouvernement
djiboutien signe un accord de paix avec le FRUD (Front pour la Restauration
de l’Unité et de la Démocratie), qui sera légalisé en 1996 et dont les
principaux chefs seront arrétés en octobre 1997.
Le Président Hassan Gouled Aptidon transmet par décret l'essentiel de
ses pouvoirs à son neveu Ismäel Omar Guelleh en 1997. En ce qui
concerne les relations avec la France, aujourd’hui ces deux pays peuvent
se féliciter d’avoir instaurer des accords de coopération fructueux.
Ainsi de nombreux français résident à Djibouti occupant des postes dans
l’éducation, l’ingeniérie, l’aide humanitaire sans compter la présence
militaire.